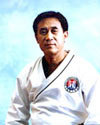
Grand Maître KIM YONG HO
Article écrit par Tan eng Bok et paru dans la revue BUDO "Du vietnam à l'académie mondiale de taekwonmudo".
9ème dan de Taekwondo, fondateur du Taekwon Mudo Président du Comité technique de la Fédération mondiale de Taekwondo (World Taekwondo Federation), de 1998 à 2001 - Président de l'Académie mondiale de Taekwon Mudo (World Taekwon Mudo Academy).
Né en 1941, le Grand Maître Kim Yong Ho a commencé la pratique des arts martiaux à Inchon en 1954, dans un gymnase affilié au Chung Do Kwan de Seoul, et dirigé par Me Kang Suh Chong. À raison de deux à trois heures d'entraînement quotidien, il a obtenu son 1er dan provisoire (chodan bo) de Tangsoodo l'année suivante; il avait alors 14 ans. Son grade fut validé en 1956, devant le Grand Maître Uhm Woon Kyu, au Chung Do Kwan à Seoul, et en devint la 61e ceinture noire (yoodanja).En débutant, comme instructeur de Tangsoodo, auprès d'une unité de l'armée américaine, Me Kim commença une carrière à la confluence des arts martiaux et des relations internationales, soutenue par une solide formation universitaire acquise dans le domaine de l'éducation physique auprès de l'université Kyung Hee. (Cette université a constitué la première équipe de Taekwondo dès 1960; elle a également créé le premier département consacré uniquement au Taekwondo, au sein du Collège d'éducation physique et des sports, sur son campus de Séoul en 1983.) Ces caractéristiques très spécifiques permettent de mieux comprendre son parcours ultérieur et, surtout, les motivations qui l'ont amenées à fonder le Taekwon Mudo, puis à se consacrer actuellement au développement du Mudo.
À l'issue de ses études universitaires (1962-1966), Me Kim remplit ses obligations militaires comme officier dans l'Armée coréenne. Il devint également 5e dan de Taekwondo - un grade très élevé à cette époque (1967). Ce fut dans ce cadre qu'il partit au Vietnam, d'abord comme conseiller auprès d'un général vietnamien. Quand celui-ci, également pratiquant de Taekwondo, prit la direction de l'École des officiers d'active à Dalat, Me Kim le suivit dans sa nouvelle affectation. Puis, au cours des six derniers mois de son séjour au Vietnam, il eut en charge la formation des gardes du corps et autres personnes responsables de la sécurité du Premier ministre vietnamien. Après le Vietnam, Me Kim eut la possibilité d'un autre séjour à l'étranger, toujours au titre de la coopération militaire. Il s'agissait, cette fois, d'un poste d'instructeur auprès des forces armées iraniennes. Après l'Iran, d'autres pays eurent le privilège de l'accueillir et profiter de son enseignement : Singapour, Malaisie, Hong Kong ...
Au terme de ce périple, il a choisi de s'établir en France depuis une vingtaine d'années, d'où il propage inlassablement le Taekwondo dans les pays limitrophes : Angleterre, Maroc, Portugal, Luxembourg, Grèce, etc.Au faîte de son parcours martial au sein du Taekwondo, il a décidé d'approfondir sa pratique en allant au-delà des seuls aspects techniques et surtout compétitifs: Selon lui, n'importe quel expert (pas nécessairement coréen) peut enseigner comment porter un coup de poing ou donner un coup de pied; il s'agit là, du niveau élémentaire de la technique ou musool. Pour être complet, un art martial - muyae - doit comporter un niveau avancé, celui de la Voie, et plus exactement de la "Voie correcte" - Jungdo - dans le domaine martial. En d'autres termes, il ne saurait avoir de muyae en se limitant au seul musool, ou en ignorant le mudo. Afin de dispenser son enseignement dans cette nouvelle direction, il a créé l'Académie mondiale de Taekwon Mudo à Darlington en Angleterre, inaugurée avec un tournoi international en octobre 1997. Dès l'année suivante, le premier championnat mondial de Taekwon Mudo fut organisé au Mexique (novembre 1998), avec la participation de dix-sept délégations en provenance de dix pays.
Enfin, le troisième événement marquant fut le championnat de Taekwon Mudo, dans le cadre du Festival mondial de Taekwondo de l'Université de Chung Cheong, à Cheongju (juillet 2000). De très grands experts l'ont rejoint dans cette entreprise qui, par ailleurs, ne se limite pas au seul Taekwondo. Pour se rendre compte de l'audience dont Me Kim Yong Ho bénéficie auprès de ses pairs, donner la seule liste des experts présents au 4e tournoi international de Taekwon Mudo au stade Charléty à Paris en novembre 2000 suffit à ce propos: Me Lee Moo Yong (9e dan, Etats-Unis), Me Lee Woon Se (9e dan, Etats-Unis), Me Moon Dae Won (9e dan, Mexique), Me Hwang Dae Jin (9e dan, Finlande), Me Kwak Ki Ok (8e dan, Ghana), Me Ahn Hen Ki (8e dan, Grèce), Choi Duk Kyu (8e dan, Grèce), Me Chung Sun Yong (8e dan, Portugal), etc. Lors de ce tournoi auquel 23 pays ont envoyé des équipes (Corée, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Inde, Maroc, Finlande, Norvège, Lettonie, etc.), les spectateurs ont également pu assister aux démonstrations suivantes: Haidong Kumdo et surtout Hapki Mudo (Me Kim Duk In, 9e dan, avec son fils Kim Beom, alors 6e dan).Ces différentes manifestations, aussi prestigieuses puissent-elles être, ne sauraient néanmoins prendre le pas sur l'essentiel: l'enseignement et la propagation du mudo, à l'origine de la création de l'académie. Une digression serait utile à cet égard: Le Kukkiwon a, pour objectif, de déévelopper les techniques, promouvoir les grades (poom et dan), améliorer la qualité des instructeurs, organiser les compétitions, et inculquer l'esprit du Taekwondo. Seulement, avec le temps, il est devenu une lourde machine privilégiant les tâches administratives au détriment des autres finalités. L'académie vise, par conséquent, à compenser ce que, par son nécessaire rôle administratif, le Kukkiwon a, vraisemblablement par la force des choses, fait passer au second plan. Elle tient également à recentrer le Taekwondo en direction de son essence martiale originelle, la pratique ne pouvant se restreindre au seul haut-niveau compétitif induit par l'Olympisme, sous peine de se transformer en sport de combat. Ce travail en profondeur passe, en particulier, par la formation et le recyclage des enseignants de Taekwondo, sous la direction de grands experts qualifiés et authentiques. Un second volet vise l'élargissement de l'horizon cognitif de ces enseignants, en les exposant aux autres facettes de la culture, de l'histoire et des traditions coréennes, au-delà des seuls arts martiaux et méthodes de combat.
NOTE:
Malgré la formation de l'Association coréenne de Taekwondo en 1959, cette discipline fut d'abord
admise par l'Association
coréenne des sports amateurs en 1962, sous l'appellation de Taesoodo. Le Taekwondo ne parviendra réellement
à s'imposer, que sous l'égide de Kim Young Chae, élu cinquième président de l'Association
coréenne de Taekwondo en 1967 - en plus de l'introduction du hogu (protection de poitrine), il fut
également à l'origine du projet de construction du Kukkiwon que son successeur, Kim Un Yong, acheva et
inaugura en 1972. Ainsi, tout au long des années cinquante et une bonne partie des années soixante,
les autres appellations avaient perdurées: Tangsoodo, Kongsoodo, Kwon Bup, Soo Bahk Do, etc. Source : Histoire moderne
du Taekwondo (en Coréen) par Kang Won Sik et Lee Kyong Myong. Seoul : Bokyung Moonhwasa, 1999.
ANNEXE 1:
développement des arts martiaux en corée du sud aprés 1945 Outre ses multiples atrocités - comme la
prostitution forcée des Coréennes au profit de sa soldatesque pendant la Seconde Guerre mondiale -
et prédations en tous genres, l'occupant japonais s'était livré à une véritable
épuration culturelle, dont les arts martiaux coréens traditionnels furent également victimes.
Il faudra attendre la défaite du Japon en 1945, pour que des écoles (kwan) et salles d'entraînement
(dojang) puissent exister et fonctionner à nouveau. Dans le domaine de ce qui deviendra le Taekwondo actuel, Chung Do
Kwan fut la première école à voir le jour. Fondée par Me Lee Won Kuk comme entité
indépendante en 1946, cette école enseignait le Tangsoodo à l'école Yong Shin depuis 1944.
A la veille de la guerre en 1953, il existait cinq écoles:
1) Chung Do Kwan (Lee Won Kuk),
2) Song Moo Kwan (Roh Byung Jick),
3) Moo Duk Kwan (Hwang Kee),
4) Chosun Yun Moo Kwan Kongsoodo Bu (Chun Sang Sup),
5) YMCA Kwon Bop Bu (Yoon Byung In).
Après la guerre, ces deux dernières écoles
s'appelleront respectivement Ji Do Kwan (Yoon Kwe Byung) et Chang Moo Kwan (Lee Nam Suk), par suite de la "disparition"
de leurs fondateurs - capturés, voire tués, par les Nord-Coréens selon certaines sources, ou
ayant fait défection au Nord selon d'autres. Les autres kwan apparus après la guerre sont tous issus de
ces cinq écoles - Oh Do Kwan (Choi Hong Hi assisté par Nam Tae Hi), Kang Duk Won (Hong Jong Pyo), Han
Moo Kwan (Lee Kyo Yoon), et Jung Do Kwan (Lee Yong Woo).
Source: Kang Won Sik et Lee Kyong Myong, op. cit.
ANNEXE 2:
les dix premiers yoodanja de chung do kwan
1. Yoo Ung Jun
2. Son Duk Sung
3. Uhm Woon Kyu
4. Hyun Jong Myun
5. Min Woon Sik
6. Han In Sook
7. Jung Young Taek
8. Kang Suh Chong
9. Baek Joon Ki
10. Nam Tae Hi
Source: Ibid.